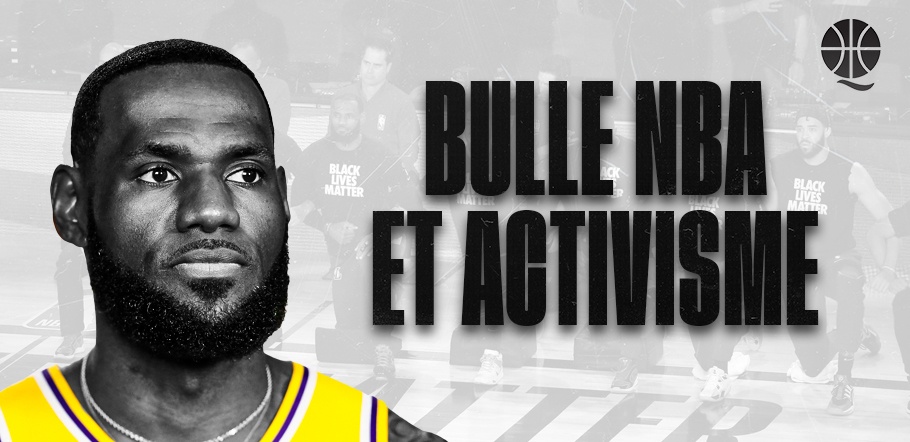Il y a quelques mois, alors qu’Adam Silver et ses équipes cherchaient un chemin au beau milieu d’une crise sanitaire mondiale sans précédent dans l’ère moderne, une seconde barrière de taille se dressait sur leur route : Black Live Matters. Dans un pays englué dans une incapacité à répondre unanimement à la crise du COVID19, venait donc s’ajouter un nouveau drame humain : le meurtre d’un citoyen noir, par un policier. Le pays se dresse devant ce nouvel acte de violence, et alors qu’un mouvement pour les droits afro-américains gonflait, les joueurs NBA décidaient d’entrer dans la danse pour contribuer au mouvement.
Les images furent alors nombreuses de joueurs arpentant les foules, prenant la parole, usant de leur notoriété et de leurs moyens financiers pour donner de l’élan au mouvement. De la contribution à l’activisme plus engagé, la communauté NBA semblait prête à jouer son rôle. A tel point qu’après plusieurs semaines de discussions, le combat contre les discriminations et violences raciales prennaient le pas sur la crise sanitaire dans la volonté de reprendre le jeu. Certes, certains joueurs s’inquiètèrent de leur santé physique (contamination, activité sportive en étant touché), mentale (éloignement familial, enfermement), mais c’est en définitive le débat autour de l’action sociale qui devint l’embuche principal pour la NBA.
Un débat entrait alors en jeu : les joueurs devaient-ils renoncer à la source première de leur exposition, aux moyens financiers que cela apporte ou devaient-ils accepter la reprise en modelant la NBA selon leurs attentes ? Trois camps se créaient alors. Ceux qui plaidaient en faveur d’une bulle construite autour de leurs revendications, ceux qui considèraient qu’un isolement représentait la fin de toutes actions sociales de poids et enfin, ceux plus en marge, priorisant leurs carrières au rôle qu’ils peuvaient jouer socialement. La question fut alors de savoir comment satisfaire un maximum. Alors qu’une dissidence se créait, notamment derrière un Kyrie Irving peu convaincu par les réponses de la NBA et de leur impact, c’est pourtant l’autre camps qui allait ramener tout le monde vers les parquets NBA. Derrière un LeBron James décidé à reprendre, l’ensemble de la ligue finisait par emboîter le pas, espérant utiliser la scène que représente la grande ligue pour faire valoir leurs droits.
Adam Silver accèdait aux requêtes des joueurs : parmi lesquelles des messages forts floqués en lieu et place des noms des joueurs, une présence du mouvement Black Live Matter inscrites sur les parquets et aux abords des terrains, la chance d’aborder le sujet médiatiquement sans censure. La NBA s’engageait plus globalement dans le soutien des joueurs, leurs préoccupations et leurs idées. Un point d’entente semblait trouvé, et, restait alors à mettre en place des solutions efficaces pour protéger la santé physique des joueurs et éviter la propagation du virus.
Fin juillet dernier, ce qui semblait alors impensable 3 mois plus tôt arrivait : la NBA reprenait ses droits. Certes sans public, mais avec une imagerie différente, construite en collaboration par les dirigeants de la ligue et les joueurs. Les inscriptions sont, depuis, nombreuses, libres, partout. Non seulement le message se veut clair, mais aussi universel car n’importe quel pays représenté en NBA peut reconnaître à tout moment un message dans sa langue.
Mais cela n’aura pas suffit. Pour apporter une perspective sur les événements récents, nous vous proposons de voguer autour de l’actualité de ce qui se produit, de poser plusieurs questions éthiques qu’elle soulève, quel que soit l’avis sur la question. L’idée ne sera pas de prendre position (tout du moins essayer), mais d’offrir des pistes de réflexion. Alors que les réseaux sociaux s’enflamment dans un manichéisme rageux, essayons de prendre du recul pour offrir des débats plutôt que des affrontements obtus.
Du cas Jacob Blake au(x) Boycott(s)
Le mouvement lancé il y a 3 mois, suite au meurtre de George Floyd par des policiers à Minneapolis, connaît un nouvel élan après cette énième violence policière. Le 24 août, Jacob Blake, 29 ans et père de 4 enfants reçoit 7 balles dans le dos après un contrôle de police. Le résident de Kenosha, dans le Wisconsin, venait d’intervenir pour séparer 2 femmes qui se disputaient… et était non armé. La vidéo de l’événement, d’une violence inouïe, relance de plus belle le débat autour des actions menées et de leur résultat.
Du côté des joueurs, c’en est trop. Les premiers à bouger sont alors les représentants de l’Etat touché par ce nouveau drame : les Milwaukee Bucks. Alors que les Celtics et Raptors se rassemblent dans l’hôtel pour discuter d’un boycott de leur première rencontre, ce sont les coéquipiers de Giannis Antetokoumpo qui décident de frapper les premiers en boycottant la rencontre les opposant au Orlando Magic, en guise de protestation.
Face à cette décision radicale, l’ensemble des équipes NBA décident d’organiser une réunion à la hâte. Que faire pour marquer le coup, semble globalement le mot d’ordre. Les joueurs sont briefés sur l’impact économique d’une absence de reprise (selon diverses sources), les joueurs discutent de comment donner suite au mouvement lancé par les Bucks (la NBA ayant décidé, alors, d’annuler tous les matchs de la soirée), de l’impact de la bulle sur leur implication et des mesures prises en accord avec la ligue sur le public.
Durant cette réunion, plusieurs sources affirment que le scénario aurait ressemblé au suivant : l’essentiel des équipes auraient votées pour une reprise des matchs suite à cette action. Deux équipes vont néanmoins s’opposer à cette décision : les Los Angeles Lakers et Clippers. Désireux d’aller plus loin, elles auraient alors quittées la réunion, annonçant leur volonté de se retirer si des actions plus radicales n’étaient pas votées. LeBron James, en tête de liste, attendrait plus d’implication dans la cause particulièrement de la part des dirigeants de franchise.
En ce faisant, les deux franchises de Los Angeles remettent en cause la saison, qui pourrait prendre fin à l’aune du combat social. La décision fait naître une série de conséquences et peut nourrir pléthore de débats, aux avis souvent très éloignés, que nous vous proposons donc d’aborder.
Reste-t-on activiste, prisonnier de la bulle ?
En acceptant de revenir en NBA, les joueurs étaient contraints d’accepter un confinement. La solution de la ligue : enfermer les joueurs à DisneyLand. Ce choix qui s’est avéré payant pour éviter la propagation du Covid19 dans les rangs, posait néanmoins un véritable problème à l’heure de revendiquer. Certes, la reprise de la NBA offrait une tribune et exposition permanente à des joueurs qui avaient certainement plus de visibilité que durant la coupure NBA. Certes, cela offrait toute une imagerie forte, emplie de messages, de questions autour du traitement de la communauté afro-américaine, mais également des questions de discriminations de tout ordre à travers le monde. Pour autant, une bulle NBA n’était-elle pas, quoi qu’il advienne, vouée à rester en premier lieu… une ode à la balle orange ? Dès lors, les joueurs pouvaient-ils continuer à jouer un rôle, à penser mouvement social alors que tout leur quotidien était tourné vers la réussite sportive. Espérer changer quelque chose dans ces conditions n’était-il pas un leurre, ou un voeu pieux ?
Les événements de ce début de semaine ont nécessairement fait (re)naître ce débat. Oui, la tribune est bien là, mais est-ce que la parole a une valeur sans action ? C’est semble-t-il une question à laquelle les joueurs ont répondu hier en décidant de boycotter une rencontre… et peut être la totalite de la reprise, en connaissance de cause.
Quelle est la mission sociale et l’influence des joueurs NBA ?
Alors que cette action coup de poing se déroule au fil des heures, une question se pose. Quelle est réellement l’impact des joueurs NBA ? Michael Jordan a prouvé dans les nineties qu’un basketteur pouvait devenir plus qu’un sportif, une star, mais une icône mondial. Si aucun joueur n’a aujourd’hui l’influence de l’ex-Bull, toujours est-il que la ligue possède aujourd’hui une visibilité sans précédent. Certes le basketball n’est pas le premier sport au monde, certes la NBA n’est pas la première ligue au monde, ni même dans le pays, mais les sportifs, à l’instar des musiciens et acteurs sont devenus ces dernières décennies de véritables leaders d’opinions. Conscients de leur notoriété, de l’inspiration qu’ils peuvent représenter pour la population et la jeunesse.
Bien sûr, on peut arguer qu’espérer des changements à travers quelques semaines de revendications et des messages portés de manière passives était naïf. Que si les joueurs ont sans l’ombre d’un doute une influence, jouant notamment le rôle de modèle, attendre de changer les choses par si peu n’avait rien de réaliste.
Pour d’autres, le scepticisme est ailleurs : est-ce que des joueurs devenus des privilégiés, n’ayant pas embrassé de fonction politique devraient être plus écoutés que quelconque autre citoyen ? Allant plus loin encore, la question serait de savoir quelle est leur légitimité pour représenter la réalité du quotidien de personnes désormais si éloin du leur ?
Pourtant, il est difficile de retirer à ces joueurs leur histoire. Considérer que l’argent, la notoriété éloignent de ces problématiques semble aussi une version très falsifiée de la réalité. Dans le seul état du Wisconsin, lieu de l’attaque contre Jacob Blake, plusieurs joueurs NBA ont eu à affronter cette dernière discriminations et violences. Considérée comme l’Etat subissant le plus fortement les problèmes de ségrégation aux USA, il a fait parler ces dernières années, y compris dans le microcosme NBA. Comme exemple, on retrouve celui de John Henson, ancien joueur de la franchise, ayant frôlé l’arrestation dans une bijouterie, le propriétaire pensant qu’il était “un cambrioleur”. Sterling Brown, encore rookie, avait eu à faire aux violences policières. Garé sur une place inadaptée, il avait été pris à partie par la police et avait reçu plusieurs coups de tazzer. Selon le joueur, l’Etat lui avait alors proposé de garder le silence sur cette “bavure” en échange d’une somme de 400.000 dollars américains.
Dès lors, si certains peuvent questionner la mission des sportifs… Qu’en est-il de celui du citoyen ?
Dans une société où les stars issues du sport sont nombreuses et surmédiatisées, où certaines jouent désormais un rôle associatif, ou part des initiatives fortes sur le plan sociétal : il est nécessaire de comprendre qu’il redevient culturel de voir des athlètes faire plus que divertir. L’exemple de LeBron James ouvrant une école pour les enfants défavorisés n’étant pas le moindre geste. Pour autant, que peuvent-ils générer par leurs seuls moyens ?
… Qu’est-ce que cela peut engendrer ?
Toutefois, si les joueurs ont une influence auprès du public, en ont-ils sur le plan politique. Cette réponse est délicate. Quand bien même l’opinion politique est une force, les joueurs possèdent-ils un pouvoir de lobbying suffisant ? Si l’idée n’est pas de répondre de manière tranchée, il convient de mettre en perspective que le plus souvent, si les joueurs font la ligue dans laquelle ils évoluent, ceux-ci n’ont pas le même pouvoir ou moyens que les dirigeants de franchises possédant des fortunes et entreprises colossales. Dans l’espoir de faire du lobbying et d’exhorter l’Etat à prendre de véritables décisions, ce sont bien vers ces hommes de l’ombre que les joueurs doivent se tourner.
Dès lors, s’il est possible de trouver naïf de la part des joueurs d’avoir des résultats rapides par leurs seuls messages, ne le serait-ce pas beaucoup moins de le part de LeBron et ses coéquipiers d’attendre des dirigeants de franchise d’entrer dans le combat ? Souvent peu en avant sur ces questions, ces derniers sont pourtant bien plus à même de réaliser un travail de l’ombre bien plus efficace. Les franchises NBA sont d’ailleurs souvent partagées entre de nombreux actionnaires possédant des moyens et une influence importante.
Exiger de leur part une position plus claire pourrait, en effet, avoir un impact national.
Les joueurs trahissent-ils Adam Silver et la NBA ?
Bien que les revendications des joueurs puissent universellement se comprendre, elles pourraient néanmoins compliquer les choses à l’avenir. Comme toutes entreprises, la NBA a pour mission principale de se développer et de générer des revenus. Dans l’optique d’éviter une catastrophe financière, cette dernière avait donc décidé de reprendre la saison, moyennant d’énormes moyens financiers et des concessions aux joueurs. Outre donc la création de la bulle, c’est aussi des revenus publicitaires que la ligue laissait tomber en mettant en avant l’ensemble des slogans autour de Black Live Matter. Parmi les oppositions à la décision des joueurs, se trouvent donc les sceptiques autour de la fracture qui pourrait se créer entre les dirigeants de la ligue et les joueurs.
Alors que les deux parties avaient trouvé un accord pour contenter les joueurs et permettre la reprise, ces derniers pourraient, pourtant, signer la fin de saison. Si l’annulation de la saison, en mars dernier, était une crainte financière pour la grande ligue, elle serait encore plus coûteuse maintenant qu’elle a engagé de nombreux coûts pour la relancer. S’il est difficile de déterminer les pertes de l’extérieur, il est fort probable qu’Adam Silver connaisse un moment difficile. Invité de la First Team durant le confinement, Nicolas Batum expliquait d’ailleurs le poids qu’avait joué la négociation de la future convention collective dans la reprise. Motivé par le fait d’éviter des déséquilibres, des baisses de salaires (perte de salary cap notamment) et d’un éventuel lock-out à venir, les deux partis avaient été contraints de trouver des points d’entente.
De fait, si la ligue a soutenu le boycott du game 5 entre Milwaukee et Orlando, en guise de geste fort, on imagine sans difficulté qu’elle est beaucoup moins encline à accepter une fin définitive de sa saison.
Par ailleurs, on peut songer que cette décision pourrait compliquer la relation entre les joueurs et les instances de la ligue dans les années à venir. Car certes, leurs motivations sont claires, sans appels et morales, mais l’engagement initial entre les deux partis pourrait bien être baffoué si les deux franchises de LA n’étaient pas contentées dans leurs attentes. De quoi risquer moins de concessions de la ligue dans le futur ?
Est-ce la renaissance de l’activisme en NBA ?
En avril dernier, François-Damien écrivait pour QiBasket un article sur l’activisme dans le sport US et en NBA. On y voyait notamment l’évolution de cette dernière de ses versions les plus radicales, à son extinction progressive entre les 80s et 00s, jusqu’à son retour plus lisse dans notre période. Pourtant, entre des joueurs très investis dans le combat ces derniers mois, à l’image d’un jeune Jaylen Brown, et le déroulement des dernières heures, les athlètes pourraient bien avoir retrouvé une véritable ampleur politique.
Car non seulement la NBA a agi, mais elle a déjà inspiré la WNBA, la MLB et des joueurs d’autres ligues à imiter leur combat. Une prise de décision qui aura un retentissement sur le sport US, mais pourrait, éventuellement, inspirer d’autres ligues et individualités à travers le monde.
Une action est-elle vertueuse que si on en ressent l’impact immédiat ?
Autre source de scepticisme : la propension des joueurs et de leurs actions à créer un résultat concret. Dans une société capitaliste, si une action nécessite des moyens, on nous a également appris qu’elle exige des résultats. Pour une part du public, toute décision d’arrêt de la saison semblant trop anecdotique pour déclencher une réaction immédiate et concrète, elle perd donc de sa légitimité.
Ce scepticisme met en exergue une question plus générale (et philosophique) sur laquelle il est nécessaire de se positionner : une action est-elle vertueuse qu’à partir du moment où elle promet un résultat ?
Puisqu’apporter une réponse à cette question serait bien prétentieux, je vous laisserai avec une ouverture. Comme on me l’a suggéré, c’est donc vers la loi morale de Kant que nous nous tounerons :
“Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est décidée.”
En somme, plutôt que de se concentrer sur la finalité de nos actions, il faudrait uniquement concentrer nos efforts sur cette dernière. En n’agissant pas, les joueurs prendraient, en quelques sortes de se détourner de ce qui est juste.
Selon Kant, nous nous devons d’agir en être moral. Pour savoir si une action est morale, il suffirait de déterminer si nous voulons faire de la “chose”, quelque chose d’universel. Ici, la réponse semble simple : voulons-nous faire des violences raciales quelque chose de moral ?
Nous nous laisserons, en disant que la suite appartient à chacun.